Editorial (abstract) Joël Dicker, écrivain suisse à la renomm... Lire la suite
N°98 – La territorialisation du droit : quelle relation entre la norme et l’espace ?
« J’ai allumé cet ordinateur aujourd’hui parce que je voulais écrire ce livre », écrit Hartmut Rosa1, « […] cependant avant de commencer à écrire, j’ai surfé rapidement sur quelques-uns des sites Web que je consulte habituellement […] à l’étape suivante, les choses ont vraiment empiré : j’ai consulté mon compte de courrier électronique ».
Qui n’a jamais ressenti que, subrepticement, une activité prenait la place d’une autre et qu’au final, nous perdions le sens de l’action initiale ? N’avez-vous jamais eu le sentiment que vous n’arriveriez jamais au bout de votre travail (un dossier, une note à rédiger, un appel téléphonique à passer…) parce que des interférences multiples prenaient le pas sur l’activité initiale ?
Parce que nos sociétés sont régies « par la force normative silencieuse de normes temporelles qui se présentent sous la forme de délais, de calendriers et de limites temporelles », il est de plus en plus difficile d’agir en prenant le temps d’aller jusqu’au bout d’une mission, d’une tâche, d’un dossier.
Ceci est d’autant plus vrai que depuis plusieurs mois, un mot revient fréquemment dans les débats publics : « la procrastination »2, c’est-à-dire l’art de reporter au lendemain. Nous serions tous des retardataires chroniques.
Rapportée à l’action publique, que signifie cette expérience avant tout subjective ? Hartmut Rosa identifie là un problème politique car « si nous voulons être des sociétés fondamentalement démocratiques, ceci signifie que la politique régule les cadres et les grandes orientations au sein desquels opèrent la science, la technologie et l’économie. Cela requiert néanmoins un ancrage très particulier de la “politique dans le temps”, c’est-à-dire que cela se fonde sur l’hypothèse que la prise de décision politique et l’évolution sociale sont — ou au moins peuvent être — synchronisée. »
C’est exactement de synchronisation et surtout de désynchronisation dont est question dans le dossier consacré à la territorialisation du droit. Derrière la question quelle relation entre la norme et l’espace ?, se cache une autre interrogation quelle relation entre la norme et le temps ?.
Comme le rappelle Jean-Marie Woehrling3, « à l’intérieur de l’espace étatique français a longtemps prévalu une vision « unitaire et indivisible » de l’organisation normative du territoire. La même loi pour tous a été comprise comme la même loi partout. La différenciation territoriale de la règle a été perçue comme une dérogation à une règle d’unité législative qui ne devait être tolérée que dans des cas limités et en raison des situations très particulières. » Norme
et territoires apparaissent comme désynchronisés. Ce numéro envisage les processus d’une resynchronisation qui demande encore davantage de temps, étant donné que la société devient davantage pluraliste et moins conventionnelle. Un encouragement : ne procrastinons plus !
49 en stock
Accéder au site dédié à la Revue
« J’ai allumé cet ordinateur aujourd’hui parce que je voulais écrire ce livre », écrit Hartmut Rosa1, « […] cependant avant de commencer à écrire, j’ai surfé rapidement sur quelques-uns des sites Web que je consulte habituellement […] à l’étape suivante, les choses ont vraiment empiré : j’ai consulté mon compte de courrier électronique ».
Qui n’a jamais ressenti que, subrepticement, une activité prenait la place d’une autre et qu’au final, nous perdions le sens de l’action initiale ? N’avez-vous jamais eu le sentiment que vous n’arriveriez jamais au bout de votre travail (un dossier, une note à rédiger, un appel téléphonique à passer…) parce que des interférences multiples prenaient le pas sur l’activité initiale ?
Parce que nos sociétés sont régies « par la force normative silencieuse de normes temporelles qui se présentent sous la forme de délais, de calendriers et de limites temporelles », il est de plus en plus difficile d’agir en prenant le temps d’aller jusqu’au bout d’une mission, d’une tâche, d’un dossier.
Ceci est d’autant plus vrai que depuis plusieurs mois, un mot revient fréquemment dans les débats publics : « la procrastination »2, c’est-à-dire l’art de reporter au lendemain. Nous serions tous des retardataires chroniques.
Rapportée à l’action publique, que signifie cette expérience avant tout subjective ? Hartmut Rosa identifie là un problème politique car « si nous voulons être des sociétés fondamentalement démocratiques, ceci signifie que la politique régule les cadres et les grandes orientations au sein desquels opèrent la science, la technologie et l’économie. Cela requiert néanmoins un ancrage très particulier de la “politique dans le temps”, c’est-à-dire que cela se fonde sur l’hypothèse que la prise de décision politique et l’évolution sociale sont — ou au moins peuvent être — synchronisée. »
C’est exactement de synchronisation et surtout de désynchronisation dont est question dans le dossier consacré à la territorialisation du droit. Derrière la question quelle relation entre la norme et l’espace ?, se cache une autre interrogation quelle relation entre la norme et le temps ?.
Comme le rappelle Jean-Marie Woehrling3, « à l’intérieur de l’espace étatique français a longtemps prévalu une vision « unitaire et indivisible » de l’organisation normative du territoire. La même loi pour tous a été comprise comme la même loi partout. La différenciation territoriale de la règle a été perçue comme une dérogation à une règle d’unité législative qui ne devait être tolérée que dans des cas limités et en raison des situations très particulières. » Norme
et territoires apparaissent comme désynchronisés. Ce numéro envisage les processus d’une resynchronisation qui demande encore davantage de temps, étant donné que la société devient davantage pluraliste et moins conventionnelle. Un encouragement : ne procrastinons plus !
Be the first to review “N°98 – La territorialisation du droit : quelle relation entre la norme et l’espace ?”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres
Articles connexes
. . .
N°98 – La territorialisation du droit : quelle relation entre la norme et l’espace ?
« J’ai allumé cet ordinateur aujourd’hui parce que je voulais écrire ce livre », écrit Hartmut Rosa1, « […] cependant avant de commencer à écrire, j’ai surfé rapidement sur quelques-uns des sites Web que je consulte habituellement […] à l’étape suivante, les choses ont vraiment empiré : j’ai consulté mon compte de courrier électronique ».
Qui n’a jamais ressenti que, subrepticement, une activité prenait la place d’une autre et qu’au final, nous perdions le sens de l’action initiale ? N’avez-vous jamais eu le sentiment que vous n’arriveriez jamais au bout de votre travail (un dossier, une note à rédiger, un appel téléphonique à passer…) parce que des interférences multiples prenaient le pas sur l’activité initiale ?
Parce que nos sociétés sont régies « par la force normative silencieuse de normes temporelles qui se présentent sous la forme de délais, de calendriers et de limites temporelles », il est de plus en plus difficile d’agir en prenant le temps d’aller jusqu’au bout d’une mission, d’une tâche, d’un dossier.
Ceci est d’autant plus vrai que depuis plusieurs mois, un mot revient fréquemment dans les débats publics : « la procrastination »2, c’est-à-dire l’art de reporter au lendemain. Nous serions tous des retardataires chroniques.
Rapportée à l’action publique, que signifie cette expérience avant tout subjective ? Hartmut Rosa identifie là un problème politique car « si nous voulons être des sociétés fondamentalement démocratiques, ceci signifie que la politique régule les cadres et les grandes orientations au sein desquels opèrent la science, la technologie et l’économie. Cela requiert néanmoins un ancrage très particulier de la “politique dans le temps”, c’est-à-dire que cela se fonde sur l’hypothèse que la prise de décision politique et l’évolution sociale sont — ou au moins peuvent être — synchronisée. »
C’est exactement de synchronisation et surtout de désynchronisation dont est question dans le dossier consacré à la territorialisation du droit. Derrière la question quelle relation entre la norme et l’espace ?, se cache une autre interrogation quelle relation entre la norme et le temps ?.
Comme le rappelle Jean-Marie Woehrling3, « à l’intérieur de l’espace étatique français a longtemps prévalu une vision « unitaire et indivisible » de l’organisation normative du territoire. La même loi pour tous a été comprise comme la même loi partout. La différenciation territoriale de la règle a été perçue comme une dérogation à une règle d’unité législative qui ne devait être tolérée que dans des cas limités et en raison des situations très particulières. » Norme
et territoires apparaissent comme désynchronisés. Ce numéro envisage les processus d’une resynchronisation qui demande encore davantage de temps, étant donné que la société devient davantage pluraliste et moins conventionnelle. Un encouragement : ne procrastinons plus !
49 en stock
Accéder au site dédié à la Revue« J’ai allumé cet ordinateur aujourd’hui parce que je voulais écrire ce livre », écrit Hartmut Rosa1, « […] cependant avant de commencer à écrire, j’ai surfé rapidement sur quelques-uns des sites Web que je consulte habituellement […] à l’étape suivante, les choses ont vraiment empiré : j’ai consulté mon compte de courrier électronique ».
Qui n’a jamais ressenti que, subrepticement, une activité prenait la place d’une autre et qu’au final, nous perdions le sens de l’action initiale ? N’avez-vous jamais eu le sentiment que vous n’arriveriez jamais au bout de votre travail (un dossier, une note à rédiger, un appel téléphonique à passer…) parce que des interférences multiples prenaient le pas sur l’activité initiale ?
Parce que nos sociétés sont régies « par la force normative silencieuse de normes temporelles qui se présentent sous la forme de délais, de calendriers et de limites temporelles », il est de plus en plus difficile d’agir en prenant le temps d’aller jusqu’au bout d’une mission, d’une tâche, d’un dossier.
Ceci est d’autant plus vrai que depuis plusieurs mois, un mot revient fréquemment dans les débats publics : « la procrastination »2, c’est-à-dire l’art de reporter au lendemain. Nous serions tous des retardataires chroniques.
Rapportée à l’action publique, que signifie cette expérience avant tout subjective ? Hartmut Rosa identifie là un problème politique car « si nous voulons être des sociétés fondamentalement démocratiques, ceci signifie que la politique régule les cadres et les grandes orientations au sein desquels opèrent la science, la technologie et l’économie. Cela requiert néanmoins un ancrage très particulier de la “politique dans le temps”, c’est-à-dire que cela se fonde sur l’hypothèse que la prise de décision politique et l’évolution sociale sont — ou au moins peuvent être — synchronisée. »
C’est exactement de synchronisation et surtout de désynchronisation dont est question dans le dossier consacré à la territorialisation du droit. Derrière la question quelle relation entre la norme et l’espace ?, se cache une autre interrogation quelle relation entre la norme et le temps ?.
Comme le rappelle Jean-Marie Woehrling3, « à l’intérieur de l’espace étatique français a longtemps prévalu une vision « unitaire et indivisible » de l’organisation normative du territoire. La même loi pour tous a été comprise comme la même loi partout. La différenciation territoriale de la règle a été perçue comme une dérogation à une règle d’unité législative qui ne devait être tolérée que dans des cas limités et en raison des situations très particulières. » Norme
et territoires apparaissent comme désynchronisés. Ce numéro envisage les processus d’une resynchronisation qui demande encore davantage de temps, étant donné que la société devient davantage pluraliste et moins conventionnelle. Un encouragement : ne procrastinons plus !
Be the first to review “N°98 – La territorialisation du droit : quelle relation entre la norme et l’espace ?”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres

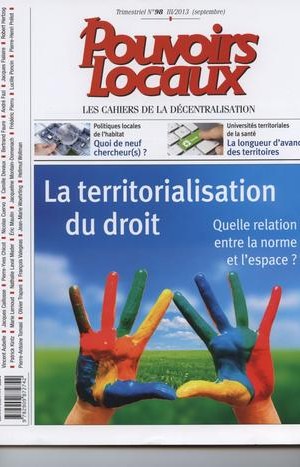
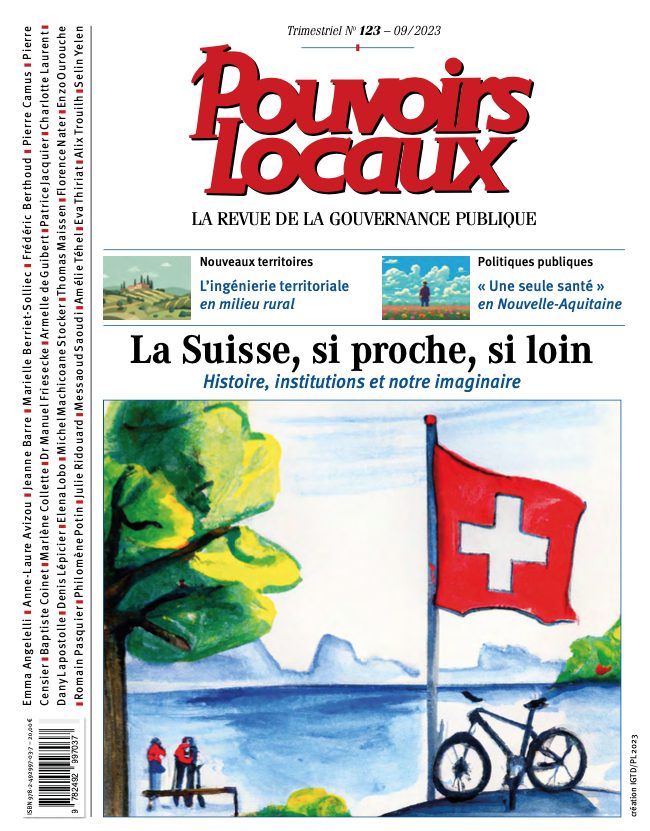

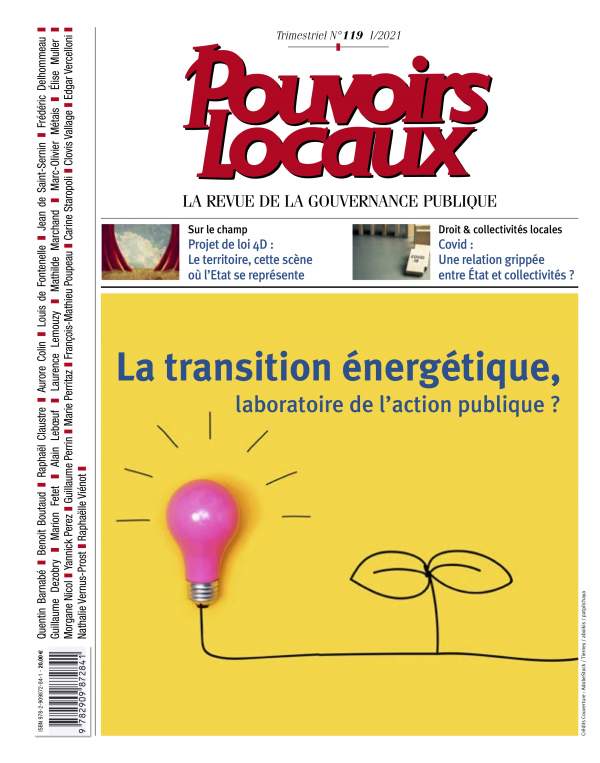
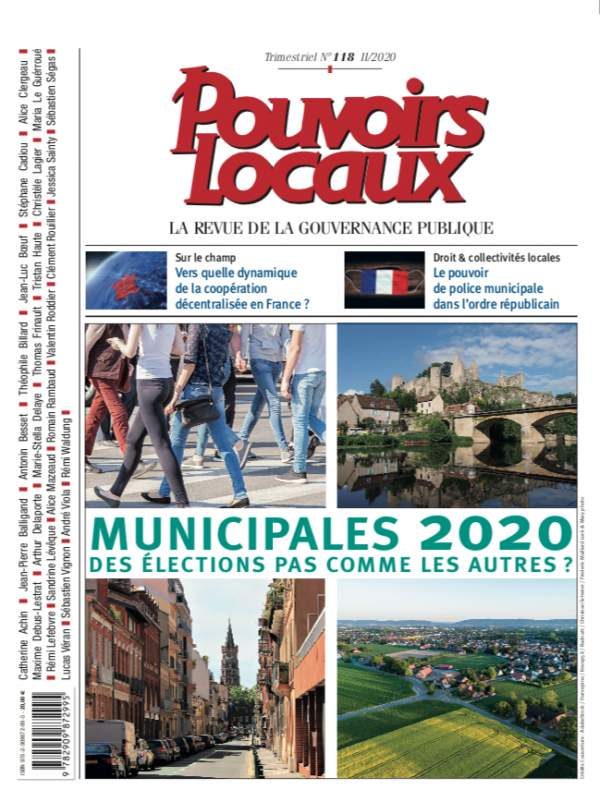






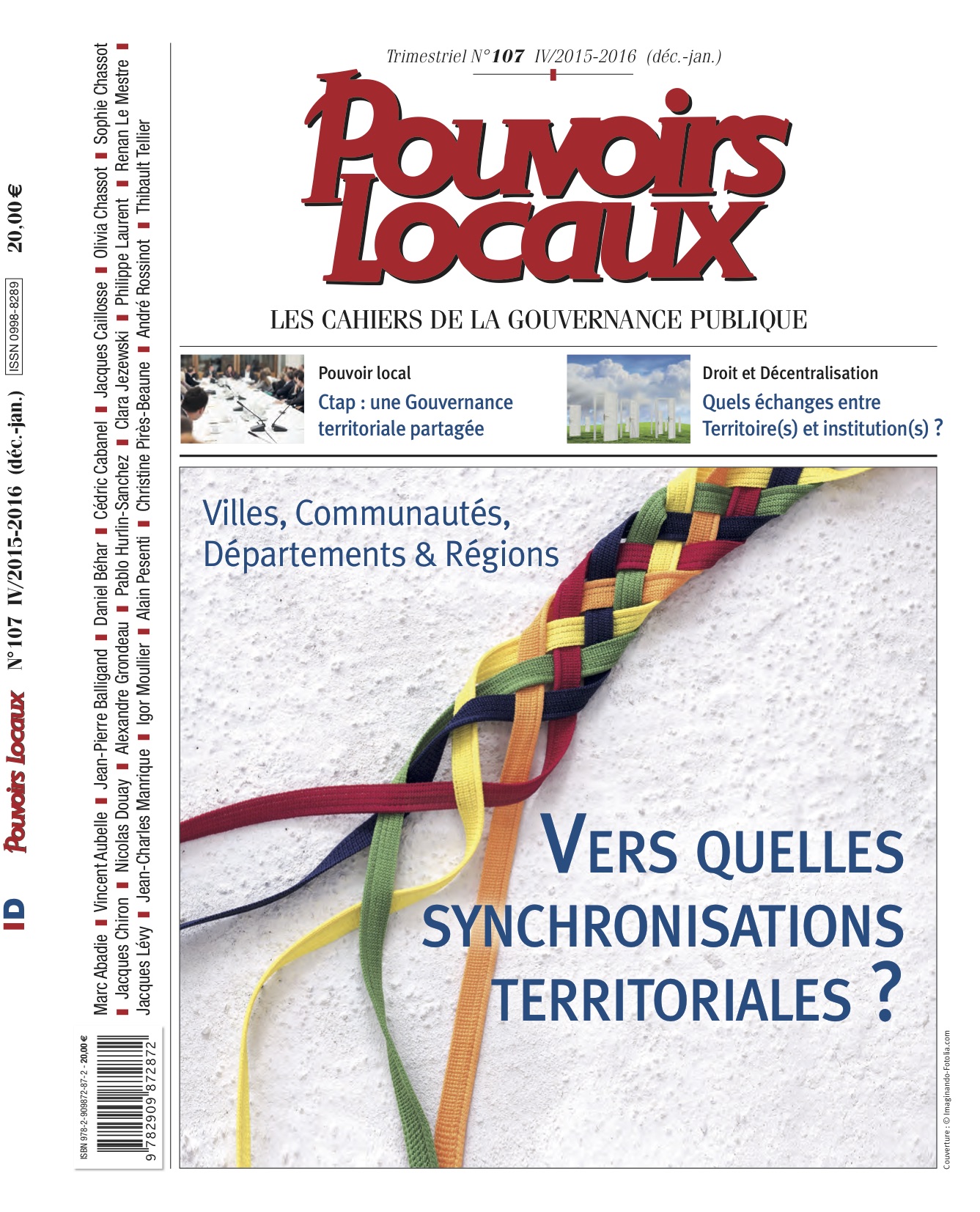
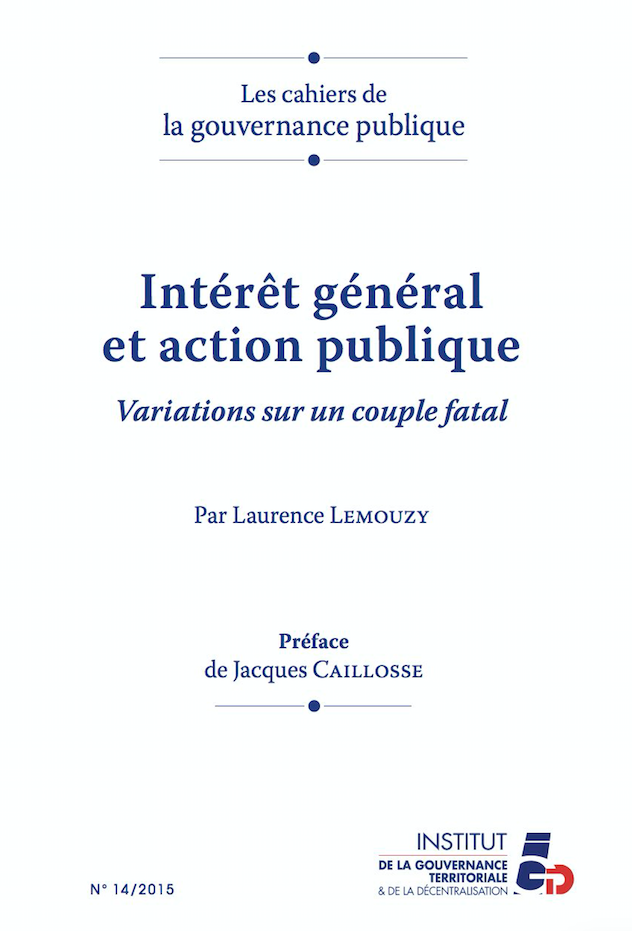
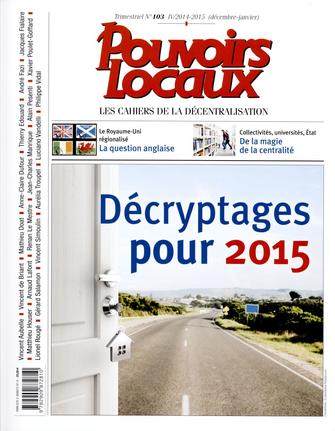

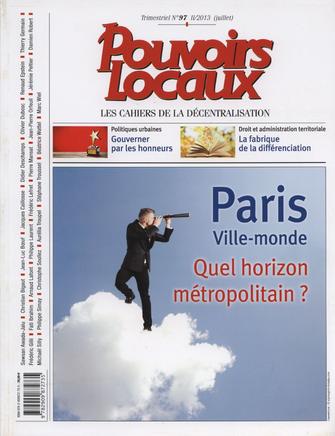
Avis
Il n’y pas encore d’avis.