Editorial (abstract) Les injonctions à davantage de proximité,... Lire la suite
N°95 – Finances publiques
En 1982, les lois de décentralisation visaient un triple objectif. Le premier consistait à dépasser un certain nombre de limites de la démocratie représentative. On attendait du gouvernement à une échelle réduite qu’il permette l’innovation démocratique. Le deuxième objectif était de fournir un cadre adéquat à une action de modernisation de l’action publique. Le troisième visait à rapprocher les citoyens de leurs élus en les éloignant d’un État empesé. Il semble aujourd’hui que nous sommes parvenus à un épuisement des discours et des actes sur
ces trois objectifs comme si sonnait la fin de l’évidence décentralisatrice.
Il reste sans doute une grande question posée à la décentralisation et qui se pose en fait aux acteurs territoriaux et donc à l’État tout entier : comme redéfinir l’intérêt général ? L’intérêt général n’apparaît plus comme une donne claire mais comme un “construit” qui ne peut se déterminer que dans la confrontation, l’incertitude et la discussion entre des acteurs nationaux et territoriaux, publics et privés.
De ce point de vue, la décentralisation a été jusque-là un processus administratif – opposant trop souvent État et collectivités territoriales – qui a évité le cœur du politique, à savoir la définition de la construction de l’intérêt général. Or aujourd’hui, le malaise social, politique et économique tient à la difficulté de construire l’intérêt général. Devant cette difficulté, il n’est pas étonnant que se soit développé un débat souvent simpliste sur l’État, instrumentalisateur des collectivités territoriales et sur des collectivités territoriales, gaspilleuse des ressources nationales. Il est plus facile en effet de tracer une frontière entre l’État et les collectivités territoriales que de construire, ensemble, l’intérêt général. Le découpage administratif a servi de ce point de vue de substitut à la difficulté de vivre ensemble.
La fin de l’évidence décentralisatrice version 1982 est aussi une chance à saisir au sens où État et acteurs publics territoriaux n’ont jamais autant eu leurs destins liés. Le discours politique actuel ne s’y trompe pas en substituant de plus en plus le terme de gouvernance territoriale à celui de décentralisation. Ce vocable témoigne – on peut l’espérer – d’une volonté politique favorisant la construction d’un intérêt général qui relèverait plus systématiquement d’un construit négocié entre des intérêts nationaux, des intérêts privés et des intérêts territoriaux.
49 en stock
Accéder au site dédié à la Revue
En 1982, les lois de décentralisation visaient un triple objectif. Le premier consistait à dépasser un certain nombre de limites de la démocratie représentative. On attendait du gouvernement à une échelle réduite qu’il permette l’innovation démocratique. Le deuxième objectif était de fournir un cadre adéquat à une action de modernisation de l’action publique. Le troisième visait à rapprocher les citoyens de leurs élus en les éloignant d’un État empesé. Il semble aujourd’hui que nous sommes parvenus à un épuisement des discours et des actes sur
ces trois objectifs comme si sonnait la fin de l’évidence décentralisatrice.
Il reste sans doute une grande question posée à la décentralisation et qui se pose en fait aux acteurs territoriaux et donc à l’État tout entier : comme redéfinir l’intérêt général ? L’intérêt général n’apparaît plus comme une donne claire mais comme un “construit” qui ne peut se déterminer que dans la confrontation, l’incertitude et la discussion entre des acteurs nationaux et territoriaux, publics et privés.
De ce point de vue, la décentralisation a été jusque-là un processus administratif – opposant trop souvent État et collectivités territoriales – qui a évité le cœur du politique, à savoir la définition de la construction de l’intérêt général. Or aujourd’hui, le malaise social, politique et économique tient à la difficulté de construire l’intérêt général. Devant cette difficulté, il n’est pas étonnant que se soit développé un débat souvent simpliste sur l’État, instrumentalisateur des collectivités territoriales et sur des collectivités territoriales, gaspilleuse des ressources nationales. Il est plus facile en effet de tracer une frontière entre l’État et les collectivités territoriales que de construire, ensemble, l’intérêt général. Le découpage administratif a servi de ce point de vue de substitut à la difficulté de vivre ensemble.
La fin de l’évidence décentralisatrice version 1982 est aussi une chance à saisir au sens où État et acteurs publics territoriaux n’ont jamais autant eu leurs destins liés. Le discours politique actuel ne s’y trompe pas en substituant de plus en plus le terme de gouvernance territoriale à celui de décentralisation. Ce vocable témoigne – on peut l’espérer – d’une volonté politique favorisant la construction d’un intérêt général qui relèverait plus systématiquement d’un construit négocié entre des intérêts nationaux, des intérêts privés et des intérêts territoriaux.
Be the first to review “N°95 – Finances publiques”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres
Articles connexes
. . .
N°95 – Finances publiques
En 1982, les lois de décentralisation visaient un triple objectif. Le premier consistait à dépasser un certain nombre de limites de la démocratie représentative. On attendait du gouvernement à une échelle réduite qu’il permette l’innovation démocratique. Le deuxième objectif était de fournir un cadre adéquat à une action de modernisation de l’action publique. Le troisième visait à rapprocher les citoyens de leurs élus en les éloignant d’un État empesé. Il semble aujourd’hui que nous sommes parvenus à un épuisement des discours et des actes sur
ces trois objectifs comme si sonnait la fin de l’évidence décentralisatrice.
Il reste sans doute une grande question posée à la décentralisation et qui se pose en fait aux acteurs territoriaux et donc à l’État tout entier : comme redéfinir l’intérêt général ? L’intérêt général n’apparaît plus comme une donne claire mais comme un “construit” qui ne peut se déterminer que dans la confrontation, l’incertitude et la discussion entre des acteurs nationaux et territoriaux, publics et privés.
De ce point de vue, la décentralisation a été jusque-là un processus administratif – opposant trop souvent État et collectivités territoriales – qui a évité le cœur du politique, à savoir la définition de la construction de l’intérêt général. Or aujourd’hui, le malaise social, politique et économique tient à la difficulté de construire l’intérêt général. Devant cette difficulté, il n’est pas étonnant que se soit développé un débat souvent simpliste sur l’État, instrumentalisateur des collectivités territoriales et sur des collectivités territoriales, gaspilleuse des ressources nationales. Il est plus facile en effet de tracer une frontière entre l’État et les collectivités territoriales que de construire, ensemble, l’intérêt général. Le découpage administratif a servi de ce point de vue de substitut à la difficulté de vivre ensemble.
La fin de l’évidence décentralisatrice version 1982 est aussi une chance à saisir au sens où État et acteurs publics territoriaux n’ont jamais autant eu leurs destins liés. Le discours politique actuel ne s’y trompe pas en substituant de plus en plus le terme de gouvernance territoriale à celui de décentralisation. Ce vocable témoigne – on peut l’espérer – d’une volonté politique favorisant la construction d’un intérêt général qui relèverait plus systématiquement d’un construit négocié entre des intérêts nationaux, des intérêts privés et des intérêts territoriaux.
49 en stock
Accéder au site dédié à la RevueEn 1982, les lois de décentralisation visaient un triple objectif. Le premier consistait à dépasser un certain nombre de limites de la démocratie représentative. On attendait du gouvernement à une échelle réduite qu’il permette l’innovation démocratique. Le deuxième objectif était de fournir un cadre adéquat à une action de modernisation de l’action publique. Le troisième visait à rapprocher les citoyens de leurs élus en les éloignant d’un État empesé. Il semble aujourd’hui que nous sommes parvenus à un épuisement des discours et des actes sur
ces trois objectifs comme si sonnait la fin de l’évidence décentralisatrice.
Il reste sans doute une grande question posée à la décentralisation et qui se pose en fait aux acteurs territoriaux et donc à l’État tout entier : comme redéfinir l’intérêt général ? L’intérêt général n’apparaît plus comme une donne claire mais comme un “construit” qui ne peut se déterminer que dans la confrontation, l’incertitude et la discussion entre des acteurs nationaux et territoriaux, publics et privés.
De ce point de vue, la décentralisation a été jusque-là un processus administratif – opposant trop souvent État et collectivités territoriales – qui a évité le cœur du politique, à savoir la définition de la construction de l’intérêt général. Or aujourd’hui, le malaise social, politique et économique tient à la difficulté de construire l’intérêt général. Devant cette difficulté, il n’est pas étonnant que se soit développé un débat souvent simpliste sur l’État, instrumentalisateur des collectivités territoriales et sur des collectivités territoriales, gaspilleuse des ressources nationales. Il est plus facile en effet de tracer une frontière entre l’État et les collectivités territoriales que de construire, ensemble, l’intérêt général. Le découpage administratif a servi de ce point de vue de substitut à la difficulté de vivre ensemble.
La fin de l’évidence décentralisatrice version 1982 est aussi une chance à saisir au sens où État et acteurs publics territoriaux n’ont jamais autant eu leurs destins liés. Le discours politique actuel ne s’y trompe pas en substituant de plus en plus le terme de gouvernance territoriale à celui de décentralisation. Ce vocable témoigne – on peut l’espérer – d’une volonté politique favorisant la construction d’un intérêt général qui relèverait plus systématiquement d’un construit négocié entre des intérêts nationaux, des intérêts privés et des intérêts territoriaux.
Be the first to review “N°95 – Finances publiques”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres

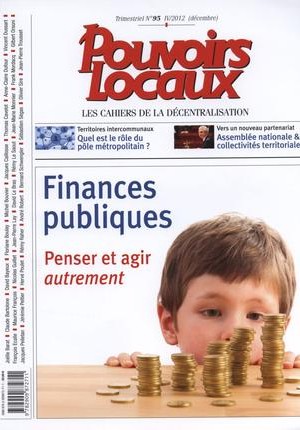





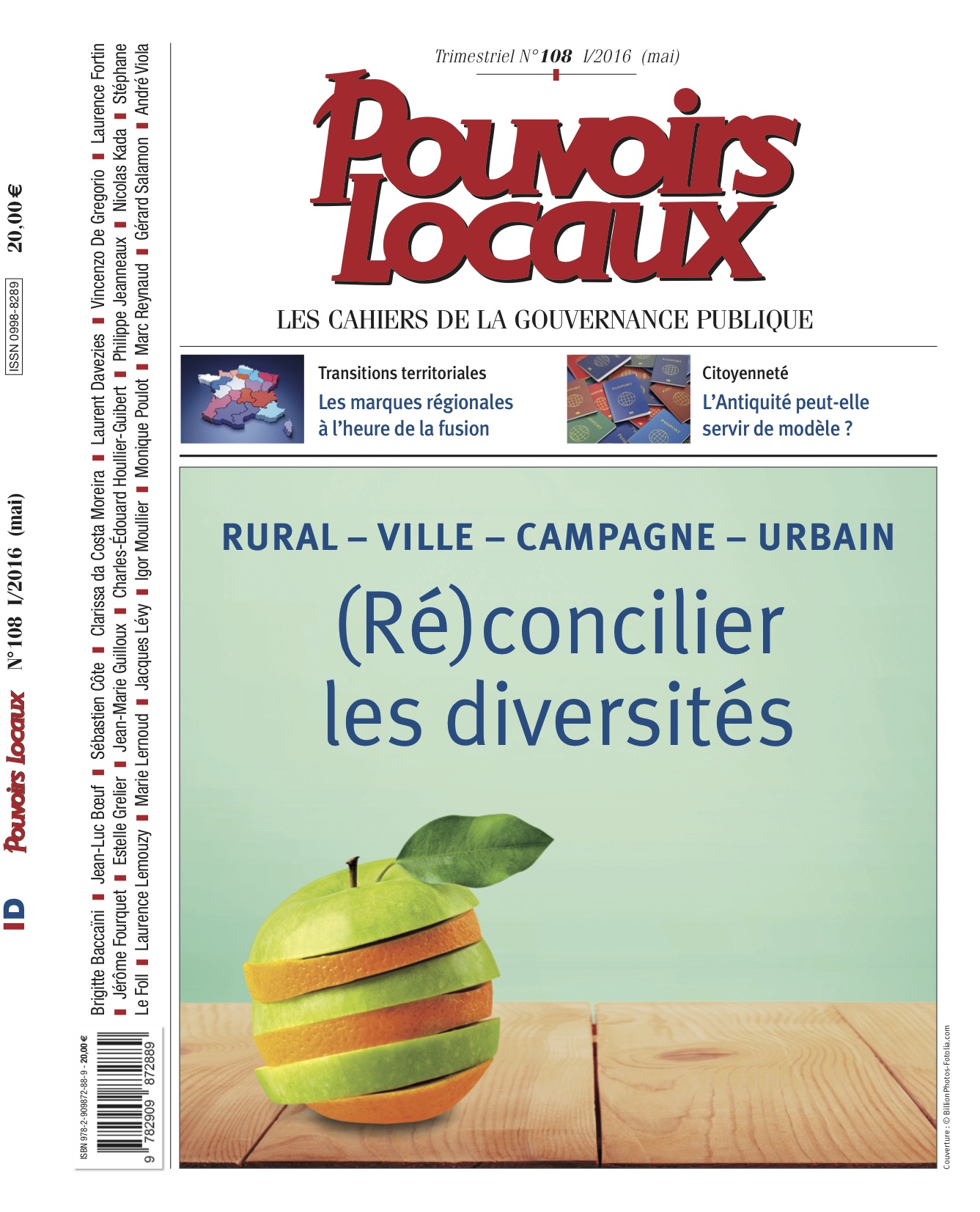

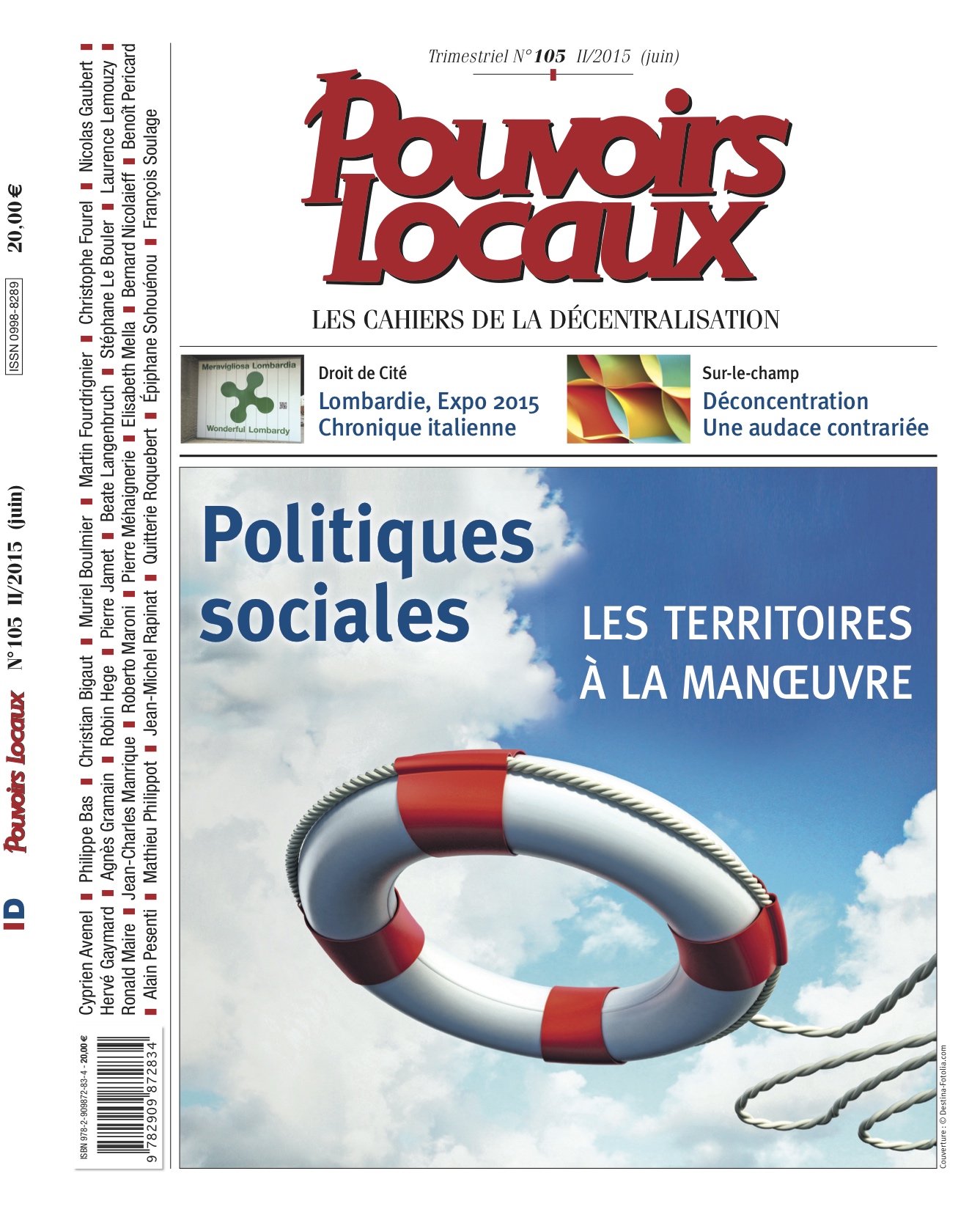

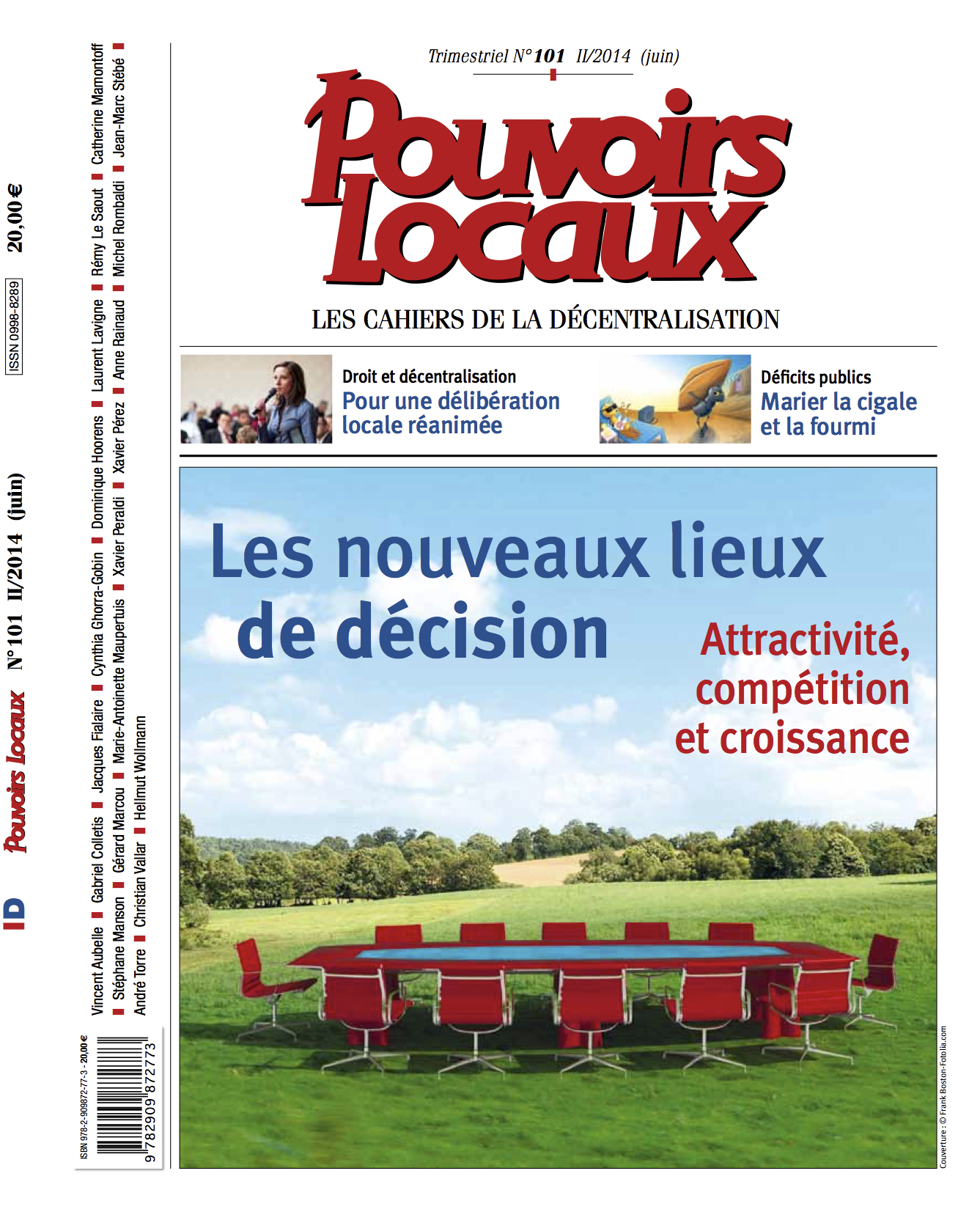


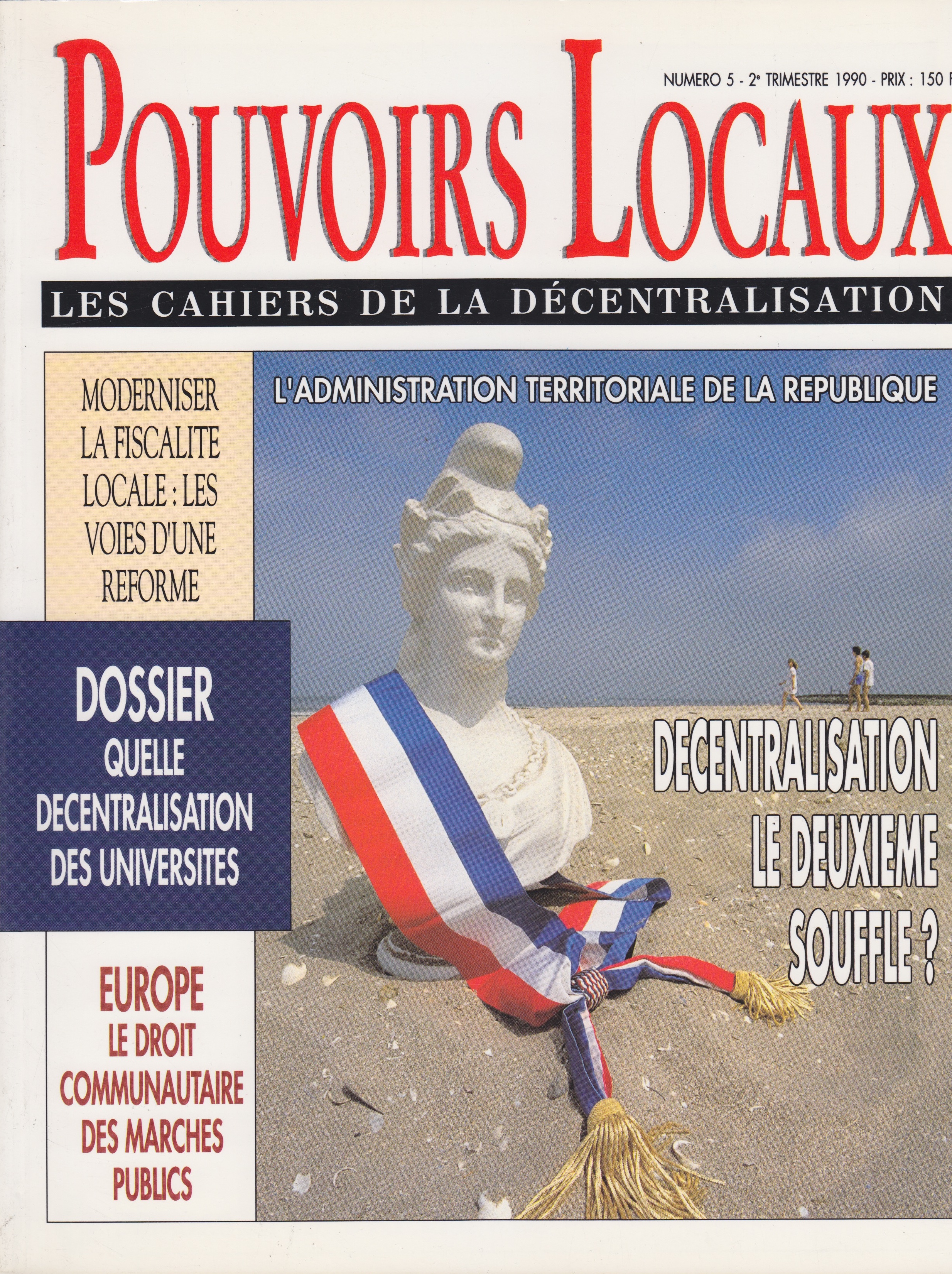
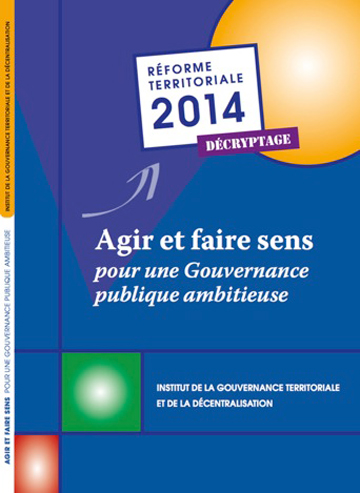
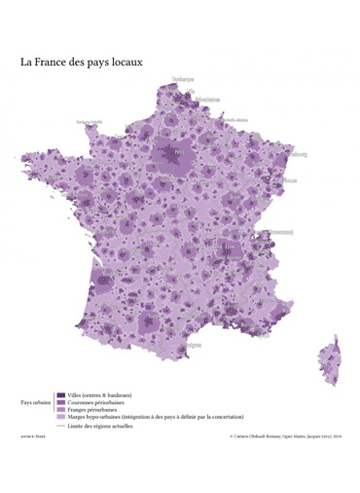
Avis
Il n’y pas encore d’avis.