Editorial (abstract) Les injonctions à davantage de proximité,... Lire la suite
N°91 – Etat, Gouvernance et Territoires
La sémantique en dit long sur les évolutions de l’organisation administrative de l’État. Dans les écrits et les discours, la déconcentration n’est plus citée. Après les « services extérieurs », les « services déconcentrés » ne sont pas davantage requis dans le langage administratif. La formulation « État territorial » s’est imposée depuis 2008 et avec elle un nouveau registre pour dire et penser le rôle de l’État dans les territoires. Que faut-il en conclure (du moins provisoirement) ? Comme le souligne Bernard Nicolaeiff, l’analyse de la Réforme de l’administration territoriale (RéATE) et du décret de 2010 fait émerger un constat signifiant1. C’est la première fois depuis 1982 qu’une réforme territoriale de l’État ne se construit pas en pure réaction à des transferts de compétences ou en contrepoint obligé de la décentralisation, que l’on songe aux lois et décrets de 1982, de 1992, de 2004. L’État territorial se substitue ainsi, discrètement en tant que concept, à celui de déconcentration. Est-ce si nouveau ? En 2004, dans les colonnes de Pouvoirs Locaux, Jacques Caillosse analysait déjà cet investissement symbolique comme partie prenante d’une stratégie de l’État pour continuer à maîtriser le local2. Dans ce mouvement, le terme même de « décentralisation » semble daté, comme épuisé par trente années de réformes et de débats. La décentralisation possède aujourd’hui un handicap discursif. On ne sait plus comment parler d’elle. Le problème est moins « que faire en matière de décentralisation ? » mais davantage « comment en parler ? ». De ce point de vue, la conversation publique ne devrait-elle pas évoluer en glissant du sujet de décentralisation à celui de gouvernance territoriale – permettant ainsi d’englober dans le « local » à la fois l’État et les collectivités territoriales ? Il n’est sans doute pas innocent que Jean-Pierre Balligand ait proposé3 de faire évoluer la dénomination de l’Institut de la Décentralisation vers « l’Institut de la Gouvernance territoriale ». Les mots ont encore un sens et de ce point de vue, ils indiquent qu’il nous faut aujourd’hui trouver un autre point de départ pour penser l’avenir des territoires. À moins de parler autrement, il nous sera difficile de penser différemment et par là même de sortir des controverses sur le millefeuille territorial la dialectique, Unité/Diversité ou le partage Politique/Administration. Si le débat public s’approprie désormais les mots de « différenciation territoriale », de « co-production » d’action publique, de « pouvoir législatif d’attribution », alors pourra émerger une véritable République des territoires. Nos sociétés sont sous l’emprise de l’instantanéité, celle-ci entraînant une complexité accrue. Dans ce contexte, l’art de gouverner, c’est-à-dire exercer une autorité, est confronté à un choix : soit l’autorité s’incarne par le seul principe de la verticalité, du haut vers le bas, du centre vers la périphérie ; soit l’autorité s’exprime selon les pratiques de la gouvernance, c’est-à-dire que s’ajoute au principe de verticalité, l’expression d’autres légitimités, celles communément appelées des parties prenantes. La crise que traversent les démocraties occidentales montre bien que les enjeux de bonne gouvernance concernent aussi bien les échelles locale, nationale que globale.
From local to global governance !
50 en stock
Accéder au site dédié à la Revue
La sémantique en dit long sur les évolutions de l’organisation administrative de l’État. Dans les écrits et les discours, la déconcentration n’est plus citée. Après les « services extérieurs », les « services déconcentrés » ne sont pas davantage requis dans le langage administratif. La formulation « État territorial » s’est imposée depuis 2008 et avec elle un nouveau registre pour dire et penser le rôle de l’État dans les territoires. Que faut-il en conclure (du moins provisoirement) ? Comme le souligne Bernard Nicolaeiff, l’analyse de la Réforme de l’administration territoriale (RéATE) et du décret de 2010 fait émerger un constat signifiant1. C’est la première fois depuis 1982 qu’une réforme territoriale de l’État ne se construit pas en pure réaction à des transferts de compétences ou en contrepoint obligé de la décentralisation, que l’on songe aux lois et décrets de 1982, de 1992, de 2004. L’État territorial se substitue ainsi, discrètement en tant que concept, à celui de déconcentration. Est-ce si nouveau ? En 2004, dans les colonnes de Pouvoirs Locaux, Jacques Caillosse analysait déjà cet investissement symbolique comme partie prenante d’une stratégie de l’État pour continuer à maîtriser le local2. Dans ce mouvement, le terme même de « décentralisation » semble daté, comme épuisé par trente années de réformes et de débats. La décentralisation possède aujourd’hui un handicap discursif. On ne sait plus comment parler d’elle. Le problème est moins « que faire en matière de décentralisation ? » mais davantage « comment en parler ? ». De ce point de vue, la conversation publique ne devrait-elle pas évoluer en glissant du sujet de décentralisation à celui de gouvernance territoriale – permettant ainsi d’englober dans le « local » à la fois l’État et les collectivités territoriales ? Il n’est sans doute pas innocent que Jean-Pierre Balligand ait proposé de faire évoluer la dénomination de l’Institut de la Décentralisation vers « l’Institut de la Gouvernance territoriale ». Les mots ont encore un sens et de ce point de vue, ils indiquent qu’il nous faut aujourd’hui trouver un autre point de départ pour penser l’avenir des territoires. À moins de parler autrement, il nous sera difficile de penser différemment et par là même de sortir des controverses sur le millefeuille territorial la dialectique, Unité/Diversité ou le partage Politique/Administration. Si le débat public s’approprie désormais les mots de « différenciation territoriale », de « co-production » d’action publique, de « pouvoir législatif d’attribution », alors pourra émerger une véritable République des territoires. Nos sociétés sont sous l’emprise de l’instantanéité, celle-ci entraînant une complexité accrue. Dans ce contexte, l’art de gouverner, c’est-à-dire exercer une autorité, est confronté à un choix : soit l’autorité s’incarne par le seul principe de la verticalité, du haut vers le bas, du centre vers la périphérie ; soit l’autorité s’exprime selon les pratiques de la gouvernance, c’est-à-dire que s’ajoute au principe de verticalité, l’expression d’autres légitimités, celles communément appelées des parties prenantes. La crise que traversent les démocraties occidentales montre bien que les enjeux de bonne gouvernance concernent aussi bien les échelles locale, nationale que globale.
From local to global governance !
Be the first to review “N°91 – Etat, Gouvernance et Territoires”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres
Articles connexes
. . .
N°91 – Etat, Gouvernance et Territoires
La sémantique en dit long sur les évolutions de l’organisation administrative de l’État. Dans les écrits et les discours, la déconcentration n’est plus citée. Après les « services extérieurs », les « services déconcentrés » ne sont pas davantage requis dans le langage administratif. La formulation « État territorial » s’est imposée depuis 2008 et avec elle un nouveau registre pour dire et penser le rôle de l’État dans les territoires. Que faut-il en conclure (du moins provisoirement) ? Comme le souligne Bernard Nicolaeiff, l’analyse de la Réforme de l’administration territoriale (RéATE) et du décret de 2010 fait émerger un constat signifiant1. C’est la première fois depuis 1982 qu’une réforme territoriale de l’État ne se construit pas en pure réaction à des transferts de compétences ou en contrepoint obligé de la décentralisation, que l’on songe aux lois et décrets de 1982, de 1992, de 2004. L’État territorial se substitue ainsi, discrètement en tant que concept, à celui de déconcentration. Est-ce si nouveau ? En 2004, dans les colonnes de Pouvoirs Locaux, Jacques Caillosse analysait déjà cet investissement symbolique comme partie prenante d’une stratégie de l’État pour continuer à maîtriser le local2. Dans ce mouvement, le terme même de « décentralisation » semble daté, comme épuisé par trente années de réformes et de débats. La décentralisation possède aujourd’hui un handicap discursif. On ne sait plus comment parler d’elle. Le problème est moins « que faire en matière de décentralisation ? » mais davantage « comment en parler ? ». De ce point de vue, la conversation publique ne devrait-elle pas évoluer en glissant du sujet de décentralisation à celui de gouvernance territoriale – permettant ainsi d’englober dans le « local » à la fois l’État et les collectivités territoriales ? Il n’est sans doute pas innocent que Jean-Pierre Balligand ait proposé3 de faire évoluer la dénomination de l’Institut de la Décentralisation vers « l’Institut de la Gouvernance territoriale ». Les mots ont encore un sens et de ce point de vue, ils indiquent qu’il nous faut aujourd’hui trouver un autre point de départ pour penser l’avenir des territoires. À moins de parler autrement, il nous sera difficile de penser différemment et par là même de sortir des controverses sur le millefeuille territorial la dialectique, Unité/Diversité ou le partage Politique/Administration. Si le débat public s’approprie désormais les mots de « différenciation territoriale », de « co-production » d’action publique, de « pouvoir législatif d’attribution », alors pourra émerger une véritable République des territoires. Nos sociétés sont sous l’emprise de l’instantanéité, celle-ci entraînant une complexité accrue. Dans ce contexte, l’art de gouverner, c’est-à-dire exercer une autorité, est confronté à un choix : soit l’autorité s’incarne par le seul principe de la verticalité, du haut vers le bas, du centre vers la périphérie ; soit l’autorité s’exprime selon les pratiques de la gouvernance, c’est-à-dire que s’ajoute au principe de verticalité, l’expression d’autres légitimités, celles communément appelées des parties prenantes. La crise que traversent les démocraties occidentales montre bien que les enjeux de bonne gouvernance concernent aussi bien les échelles locale, nationale que globale.
From local to global governance !
50 en stock
Accéder au site dédié à la RevueLa sémantique en dit long sur les évolutions de l’organisation administrative de l’État. Dans les écrits et les discours, la déconcentration n’est plus citée. Après les « services extérieurs », les « services déconcentrés » ne sont pas davantage requis dans le langage administratif. La formulation « État territorial » s’est imposée depuis 2008 et avec elle un nouveau registre pour dire et penser le rôle de l’État dans les territoires. Que faut-il en conclure (du moins provisoirement) ? Comme le souligne Bernard Nicolaeiff, l’analyse de la Réforme de l’administration territoriale (RéATE) et du décret de 2010 fait émerger un constat signifiant1. C’est la première fois depuis 1982 qu’une réforme territoriale de l’État ne se construit pas en pure réaction à des transferts de compétences ou en contrepoint obligé de la décentralisation, que l’on songe aux lois et décrets de 1982, de 1992, de 2004. L’État territorial se substitue ainsi, discrètement en tant que concept, à celui de déconcentration. Est-ce si nouveau ? En 2004, dans les colonnes de Pouvoirs Locaux, Jacques Caillosse analysait déjà cet investissement symbolique comme partie prenante d’une stratégie de l’État pour continuer à maîtriser le local2. Dans ce mouvement, le terme même de « décentralisation » semble daté, comme épuisé par trente années de réformes et de débats. La décentralisation possède aujourd’hui un handicap discursif. On ne sait plus comment parler d’elle. Le problème est moins « que faire en matière de décentralisation ? » mais davantage « comment en parler ? ». De ce point de vue, la conversation publique ne devrait-elle pas évoluer en glissant du sujet de décentralisation à celui de gouvernance territoriale – permettant ainsi d’englober dans le « local » à la fois l’État et les collectivités territoriales ? Il n’est sans doute pas innocent que Jean-Pierre Balligand ait proposé de faire évoluer la dénomination de l’Institut de la Décentralisation vers « l’Institut de la Gouvernance territoriale ». Les mots ont encore un sens et de ce point de vue, ils indiquent qu’il nous faut aujourd’hui trouver un autre point de départ pour penser l’avenir des territoires. À moins de parler autrement, il nous sera difficile de penser différemment et par là même de sortir des controverses sur le millefeuille territorial la dialectique, Unité/Diversité ou le partage Politique/Administration. Si le débat public s’approprie désormais les mots de « différenciation territoriale », de « co-production » d’action publique, de « pouvoir législatif d’attribution », alors pourra émerger une véritable République des territoires. Nos sociétés sont sous l’emprise de l’instantanéité, celle-ci entraînant une complexité accrue. Dans ce contexte, l’art de gouverner, c’est-à-dire exercer une autorité, est confronté à un choix : soit l’autorité s’incarne par le seul principe de la verticalité, du haut vers le bas, du centre vers la périphérie ; soit l’autorité s’exprime selon les pratiques de la gouvernance, c’est-à-dire que s’ajoute au principe de verticalité, l’expression d’autres légitimités, celles communément appelées des parties prenantes. La crise que traversent les démocraties occidentales montre bien que les enjeux de bonne gouvernance concernent aussi bien les échelles locale, nationale que globale.
From local to global governance !
Be the first to review “N°91 – Etat, Gouvernance et Territoires”
Peut-être que vous êtes intéressé par d'autres

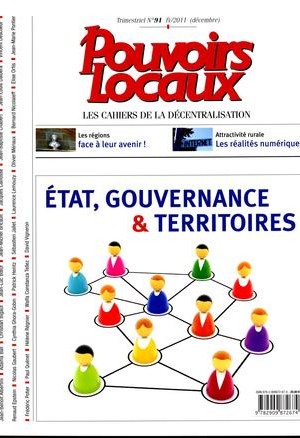

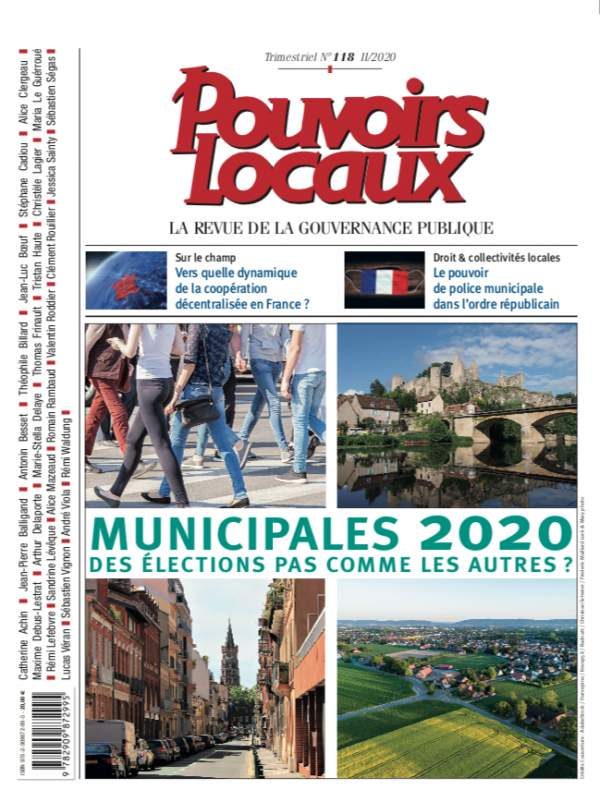




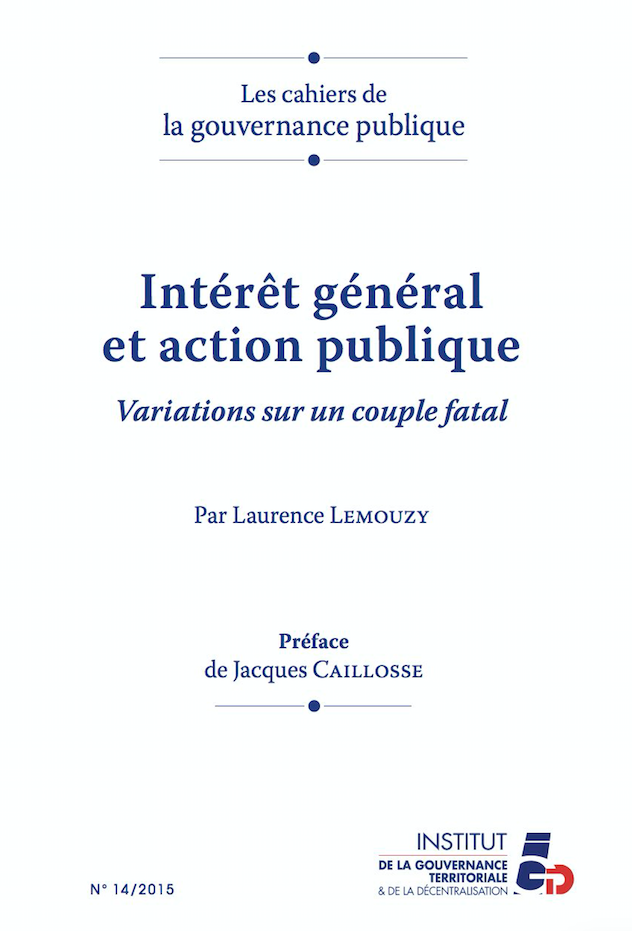


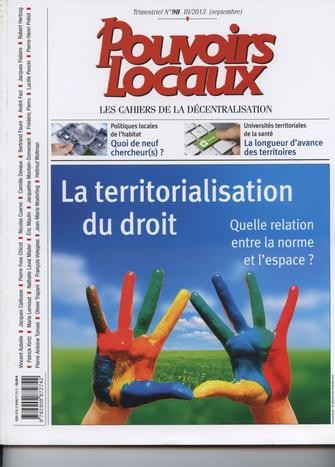
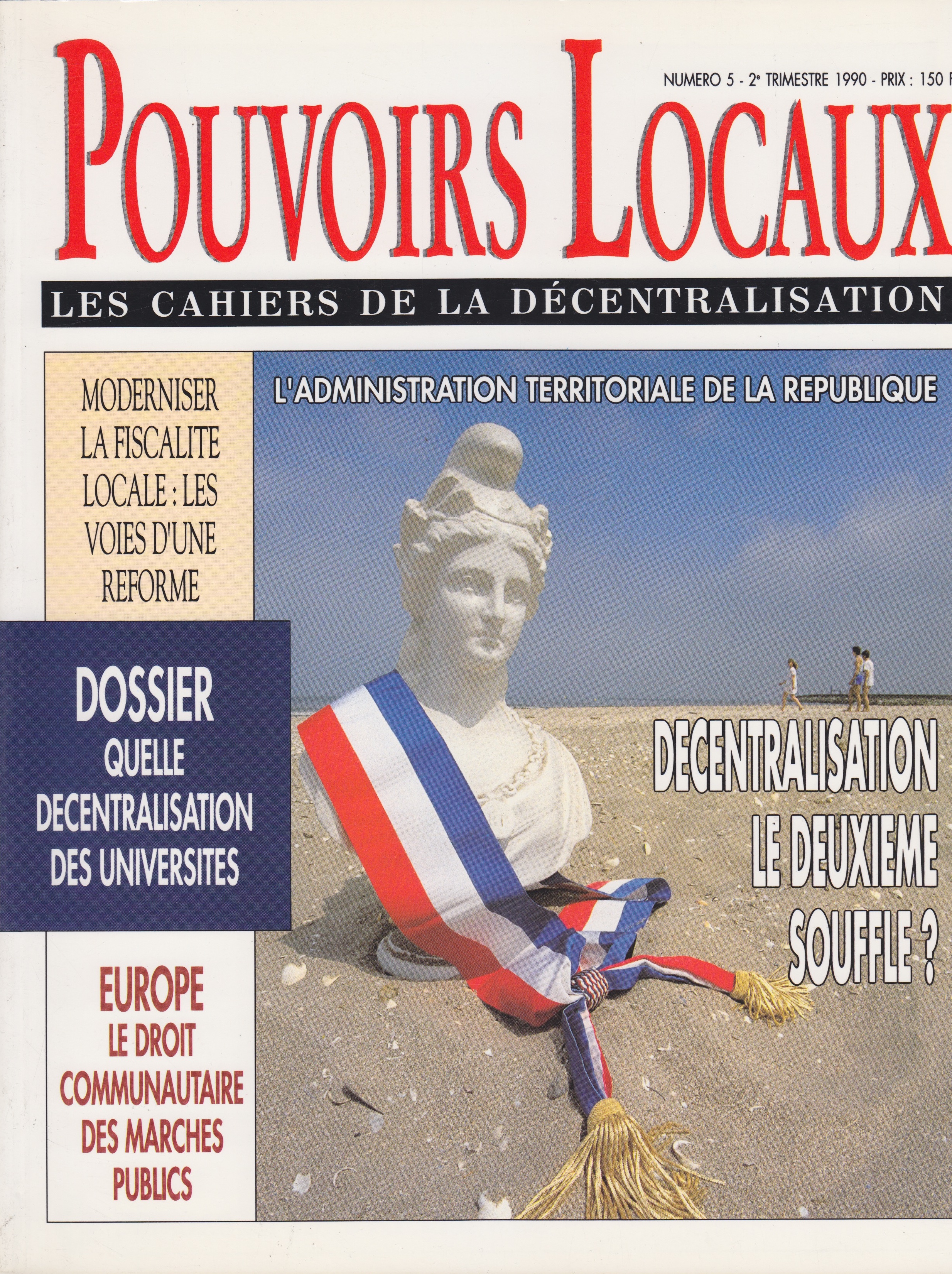
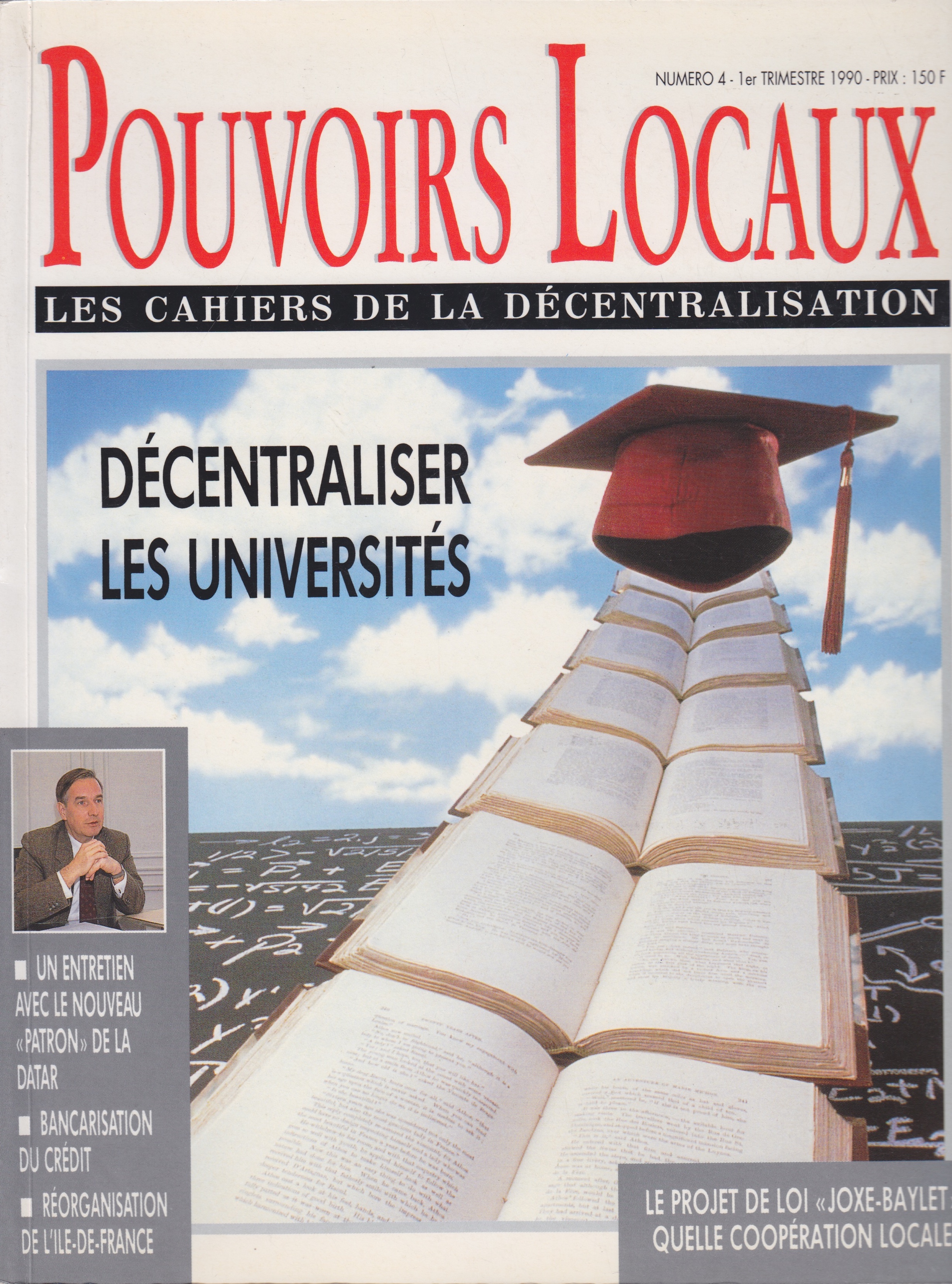
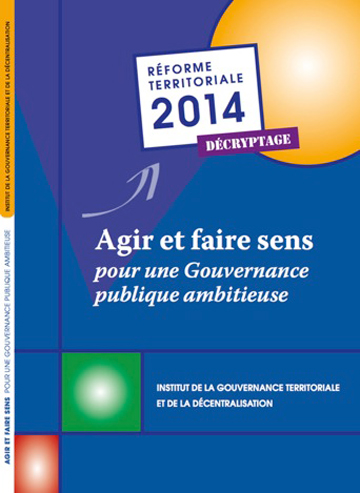
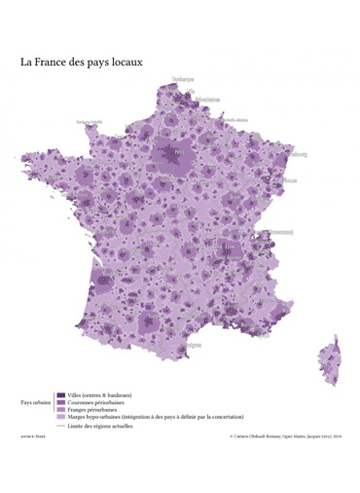
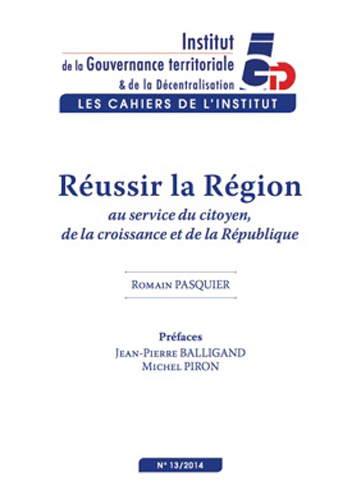
Avis
Il n’y pas encore d’avis.